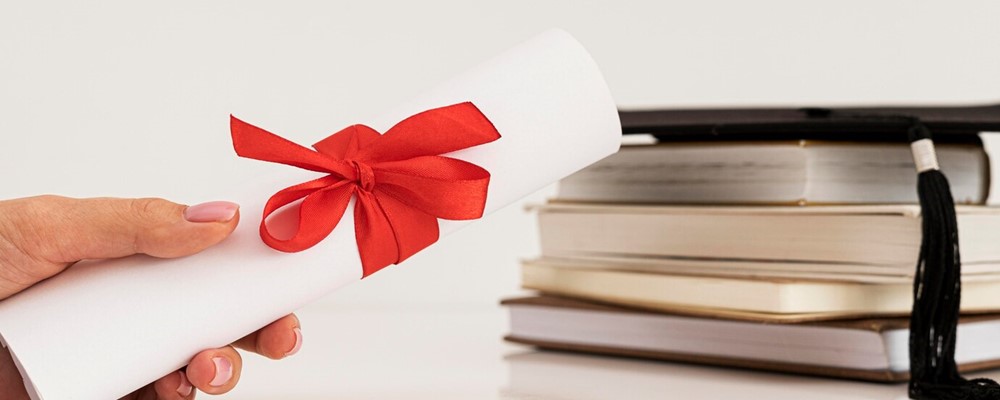L’Institut caennais de recherche juridique a le plaisir d’annoncer que le prix de thèse 2024 a été décerné à Camille Jussiaux pour sa thèse intitulée : Le droit des contrats à l’épreuve de l’activité équine.
Le jury, présidé par les codirecteurs de l’ICREJ, Eleonora Bottini et Thibault Douville, et composé des membres du conseil de laboratoire, a salué la qualité et l’originalité de ce travail.
Ce prix, d’un montant de 1500 €, a pour vocation de soutenir la publication de cette recherche auprès d’un éditeur juridique.
Résumé de la thèse
Le droit des contrats à l’épreuve de l’activité équine
Si l’exploitation du cheval est ancienne, elle a connu une mutation notable consécutivement à l’évolution des besoins de l’homme. En raison de la révolution industrielle française initiée au cours du 19e siècle, le cheval-outil a progressivement laissé sa place au cheval de sport et de loisir et l’équitation sportive a vu le jour. Ce constat, qui engendre des enjeux économiques considérables, n’est pas neutre d’un point de vue juridique. En effet, de cette mutation est née l’activité équine qui consacre le cheval en tant qu’individualité et l’érige au rang d’animal sportif. Seul le cheval bénéficie d’une telle spécificité : si certains développements peuvent ponctuellement être étendus à d’autres animaux, aucun autre que lui ne fait l’objet d’une exploitation sportive aussi récurrente, complète et développée, incluant à la fois l’exploitation des facultés sportives et reproductrices. L’exploration de ce domaine met en avant l’omniprésence d’un outil juridique incontournable pour sa mise en œuvre : le contrat. Seulement, le droit commun des contrats, général et spécial, est fondé sur la classique summa divisio des personnes et des biens.
Par conséquent, les règles juridiques préétablies ne distinguent pas selon la nature inerte ou vivante de l’objet du contrat. Plus encore, elles n’envisagent pas l’hypothèse de l’exploitation du bien vivant. Ainsi, le contrat ayant pour objet principal un cheval exploité doit trouver sa place. La doctrine et la jurisprudence disposent alors d’une grande liberté d’interprétation face à des situations atypiques et l’analyse contractuelle de l’activité équine met en lumière l’identification d’une multiplicité de figures contractuelles récurrentes. Dès lors, existe-t-il un droit des contrats spécifique à ce domaine ? Il est indéniable que la qualité de contrat emporte la soumission du contrat équin au droit général des contrats et au droit spécial, lorsqu’il entre dans la classification d’un contrat nommé. Se pose néanmoins la question de l’influence de la nature vivante et exploitée du cheval sur l’acte, tant sur son contenu que sur sa mise en œuvre.
La première partie de ces travaux est consacrée à l’identification d’un droit des contrats spécifique à l’activité équine. En s’attardant sur le contenu contractuel, elle permet d’identifier des obligations singulières et un cadre contractuel spécifique, le contrat d’exploitation, et de conclure à l’exercice d’une influence directe de l’activité équine, alors créatrice d’obligations. La seconde partie porte sur l’identification d’un droit adapté à ce domaine. L’étude du mécanisme contractuel général et de celui, plus spécial, de la vente conduisent à constater qu’il n’y a dans ce cadre qu’un aménagement de la règle juridique préétablie. L’influence est alors indirecte s’agissant de l’exécution et de la remise en cause du contrat.
Cependant, cette étude, prise dans sa globalité, permet de mettre en perspective l’existence d’un droit des contrats spécifique et d’identifier un nouveau contrat, le contrat équin ; un contrat pour lequel un régime spécial a pu être élaboré, mêlant singularités et adaptations du droit commun.